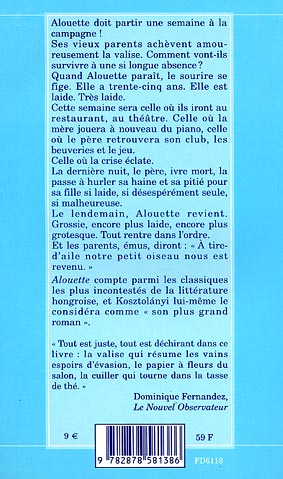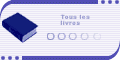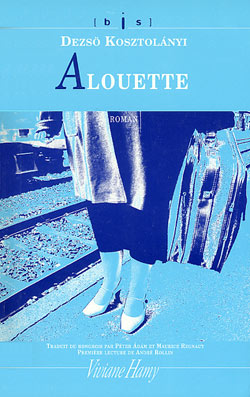
PREFACE
Kosztolányi
avait
une soeur qui était laide et qui n'a jamais pu se marier. Cette
donnée est-elle suffisante ? A-t- elle même été
nécessaire? Ce qu'on peut dire de toute façon, c'est qu'en
1923, sur le fond de cette existence provinciale qu'il a connue enfant,
Kosztoldnyi va écrire Alouette, oeuvre que lui-même considérera
comme son plus grand roman et qui de fait compte parmi les classiques
les plus indiscutés de la littérature hongroise.
Avec sa fille, laide en effet, et qui vieillit sans trouver en effet de
mari, un vieux couple, dans la ville provinciale de Sárszeg, mène
une existence banale, étriquée et sans perspective. Existence
dont le cours est rompu, un jour, par l'invitation que leur fait l'oncle
Béla de venir séjourner quelque temps chez lui, sur ses
terres, à Tarkö : les deux vieux accepteront non pour eux-mêmes,
mais pour leur fille, Alouette, qui va donc, pour la première fois,
quitter le foyer familial. Pendant toute cette semaine où leur
fille est absente, ils vont faire, eux qui se retrouvent soudainement
vacants, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'alors, manger au restaurant,
passer une soirée au théâtre, renouer d'anciennes
relations, se rendre même, en ce qui concerne au moins le vieux,
à l'hebdomadaire et fameux banquet des Guépards. La semaine
de liberté prend fin, la fille revient et tout rentre dans l'ordre.
Il faudrait dire évidemment que ce roman doit d'abord sa complexité
et sa richesse à la cohérence, à l'exactitude, à
la rigueur avec laquelle il décrit un milieu social, celui d'une
petite bourgeoisie en marge de tout, historiquement comme géographiquement.
Il faudrait dire aussi comment Kosztolányi,
qu'une grande amitié liait à Ferenczi et qui tenait Freud
pour un penseur d'importance capitale, a su présenter, avec autant
de clarté et de sobriété que de profondeur, le rituel
à la fois ordinaire et secret réglant à tous niveaux
les rapports entre ces divers personnages. Il faudrait dire du coup que,
pour flaubertien qu'il puisse paraître, à la dénégation
imperturbable, à la désespérante horizontalité
qu'est sans faillir, chez le maître français, le " tapis
roulant " narratif, le réalisme du maître hongrois ajoute
à chaque instant une dimension toute verticale, un tremblement
venu d'en dessous : Kosztolányi
est non seulement soucieux du réseau objectif des comportements,
mais attentif aussi, fidèlement attentif à l'intériorité
particulière animant chaque parole et chaque geste, et chaque personnage
a de ce fait cette paradoxale caractéristique, chez lui, d'être
à la fois inintéressant au possible et pourtant intimement
bouleversant. Il faudrait dire alors que si l'auteur d'Alouette est lui
aussi un écrivain de la platitude et de la banalité, force
est de constater que cette platitude n'est chez lui jamais sèche
et qu'elle résonne intérieurement au contraire avec toujours
un maximum d'intensité, que cette banalité n'est jamais
vide et que du quotidien elle offre toujours au contraire un compte rendu
inépuisable, il faudrait dire, en somme, du romancier d'Alouette,
en qui jamais la cruauté n'est sans tendresse et la lucidité
sans compassion, qu'il n'y a pas plus sensible peut-être et plus
pénétrant, plus grand écrivain de la plénitude
du banal.
L'essentiel à vrai dire est-il là? Est-il même dans la construction du roman, dans son impressionnante organisation structurelle? On ne peut qu'inviter le lecteur à regarder de près, successions, alternances, reprises, aussi bien les modes de progression que les constitutions de symétrie, échos de phrase à phrase et de situation à situation, renvois de chapitre à chapitre, autour du chapitre central, le septième sur les treize en tout: c'est dans ce chapitre, avec le personnage d'Ijas Miklós, que le roman tout à la fois trouve sa mise en abîme et sa " moralité " (" combien les enfants peuvent souffrir à cause de leurs parents, et les parents à cause de leurs enfants "). Ce qu'a d'absolument exemplaire une construction à la fois si simple et si savante, on ne peut qu'en toute connaissance l'attester, mais l'essentiel est cependant encore ailleurs : l'essentiel, ce qui fait du Kosztolányi d'Alouette le Kosztolányi le plus accompli, le plus singulier, le plus neuf, l'essentiel est en fait dans le statut même du roman.
De quoi s'agit-il en effet dans Alouette? Il s'agit d'une semaine " pas comme les autres ", il s'agit d'une semaine où ce qui couramment " ne se fait pas " va se faire et se faisant va montrer ce qu'il en est des choses qui couramment " se font " : cette semaine-là, ce temps étrange soudain qui s'intercale et dont l'étrangeté même a pour effet de mettre au jour le sens du temps ordinaire et banal, ce laps de temps est quelque chose, au fond, qu'on peut considérer comme analogue en tout point au lapsus. Dans le cours de l'existence normale de lafamille Vajkay, cette semaine-là va effectivement fonctionner comme fonctionne une série imprévisible, involontaire, d'actes commis à la place d'autres, à la place de ceux qui sont normalement habituels, cette semaine-là va fonctionner comme un ensemble en somme d'actes manqués, comme un immense lapsus dont le romancier va minutieusement suivre le parcours, la narration des faits devenant alors analyse en même temps d'une vérité.
Comme tout lapsus, cet accidentel phénomène est une brèche
dans l'ordre ordinaire des choses, brèche par laquelle les choses
vont par en dessous s'éclairer de leur sens véritable, et
comme tout lapsus, ce n'est qu'un phénomène accidentel et
qui finit comme il a commencé, de façon nette et radicale
et sans rapport aucun avec le reste: avant que le lapsus ait lieu, le
sens était enfoui et ne faisait qu'un avec l'ordre ordinaire des
choses, il en sera de même après le lapsus, rien n'aura changé,
tout aura simplement été révélé, tout
jusqu'au plus enfoui jusqu'au plus profond, jusqu'au plus intimement secret.
C'est durant cette semaine en effet que les deux vieux, de leur côté,
vont avoir, à propos de leur fille, la " grande explication
" qu'ils avaient toujours en eux éludée et qu'ils n'auraient
entre eux peut-être jamais eue, explication au cours de laquelle,
et clairement, violemment, va s'exprimer l'ambiguïté de leur
rapport à leur fille Alouette, attachement et ressentiment, amour
et haine, et c'est durant cette semaine également que de son côté,
là-bas à Tarkö, Alouette va écrire cette longue
lettre unique ou sera passé sous silence, où sera absent
le personnage de cet homme, là-bas, Szabó Jóska,
qui aurait pu être " le bon ", absent ici comme il le
sera aussi sur la photo qu'Alouette rapportera, cette absence renvoyant
à cette chose, à l'intérieur d'elle-même, qu'Alouette
appellera sa " transformation ". Mais quand cette semaine prendra
fin, rien ne restera de cette explication, de cette révélation
pour les deux vieux de leur amour-haine, et rien non plus ne restera de
l'homme absent, rien pour Alouette que cette " transformation "
justement, qui est prise de conscience en fait, et définitive,
de ce qu'Alouette est en elle- même: une femme que sa laideur a
condamnée à vivre seule. Il faut lire l'admirable chapitre
final pour voir de quelle façon, comme le parfait lapsus, comme
la brèche qu'elle est, cette semaine-là se referme et s'évanouit
sans que s'en suive rien: ce qui fait que le vieux, dans ce chapitre du
refermement, supprime le billet de théâtre qui, aux yeux
de leur fille, pourrait les trahir, c'est en lui cette disposition qui
fait que pour finir il est " tout heureux " de retrouver Alouette,
heureux ainsi, au fond, après la brèche et ses douloureuses
convulsions, de retrouver la quotidienne anesthésie, et ce qui
fait qu'Alouette a ce sentiment de transformation, c'est de se rendre
à l'évidence enfin de ce qu'est son destin, c'est le fait
que pour elle ce destin s'est en somme fixé. Il n'y a pas eu, en
quoi que ce soit, pour qui que ce soit, changement du sens, il n'y a eu
que coagulation. Cette coagulation du sens, cet acte intempestif n'aura
eu lieu qu'une fois, mais le sens qu'il aura, à sa manière
étrange et somme toute trop claire, accidentellement révélé,
ce sens ne cessera pas, lui, de quotidiennement se produire: ainsi
a
le roman prend fin, mais ne s'achève pas ", le lapsus meurt
comme il est né et tout, après lui comme avant, tout ce
qu'il a pu un bref instant manifester continue à courir, présent
pleinement, mais pleinement invisible, incorporé, latent, "
notre petit oiseau nous est revenu ".
Alouette:
le roman comme lapsus.
Comment ne pas conclure avec ce personnage d'Alouette? Alouette est le
surnom que lui ont
donné ses
parents, vêtement d'enfant pour lequel elle est devenue " trop
grande " et qu'elle gardera pourtant jusqu'au bout : celui seul qui
l'aurait aimée aurait pu l'appeler autrement,
aurait pu lui donner son vrai nom. Quelle justesse et quelle profondeur,
et quelle simplicité encore, dans le fait ici que ce vrai nom ne
sera jamais dit et qu'il restera inconnu ! Que dit-elle, cette absence
du nom, sinon que jusqu'au bout un mot sera prononcé à la
place d'un autre
et que tout le sens est là, dans cette substitution? Il faut lire
et relire cette brève scène, au chapitre douzième,
quand Alouette, sur le quai de la gare, arrive en pleine nuit: "
Alouette " s'écrie la mère, " Alouette "
reprend le père, " Alouette " fait écho bientôt
un chenapan, de loin, dans le noir, histoire de contrefaire l'appel des
vieux, mais cet appel lui-même, au fond, qu'est-il d'autre aussi
qu'une contrefaçon? Alouette, oui, Alouette ou le plus total, le
plus tragiquement banal des lapsus, Alouette ou la vie manquée.
Maurice
Regnaut
Paris, novembre 1990